| schema:text
| - Sur France 2, Emmanuel Macron a réfuté l'idée selon laquelle la France a traîné des pieds pour taxer les superprofits des producteurs d'énergie.Le chef de l'État estime au contraire que l'Europe s'est inspirée de la France dans le domaine.Une analyse contestable, qui mérite d'être nuancée.
Invité de France 2 mercredi soir, Emmanuel Macron s'est exprimé sur les sujets qui font l'actualité. La guerre en Ukraine, bien sûr, mais également les pénuries de carburants liées aux conflits sociaux. Au cours de l'émission, il a été interrogé sur la taxation des superprofits réalisés par les entreprises du secteur de l'énergie. Alors que la France a décidé une "contribution temporaire de solidarité", le chef de l'État a expliqué que cette dernière n'était pas imposée par l'Europe. Au contraire, assure-t-il, "c'est ce que l'Europe a repris à la France". Une réécriture de l'histoire, selon certains de ses opposants.
💶 Taxation des super-profits 🗣 « C’est ce que l’Europe a repris à la France », affirme @EmmanuelMacron , en direct dans #Levenement pic.twitter.com/rTVxOXqXV4 — L'Événement (@LevenementFTV) October 12, 2022
Des mesures difficilement comparables
Sur les réseaux sociaux, l'extrait de l'entretien relayé et commenté occulte une partie de la réponse d'Emmanuel Macron. "Cette contribution sur les surprofits que faisaient les acteurs de ces secteurs, c'est ce que nous avons fait dès le début, en demandant par exemple à contribuer davantage en garantissant de l'électricité par l'Arenh", a lancé le chef de l'État. "Ce n'est pas une taxation", assure-t-il, "c'est une contribution qui est prise et qu'on renvoie ensuite au pays. C'est ce que nous avons fait avant", poursuit le président de la République, en expliquant qu'Elisabeth Borne et Bruno le Maire ont aussi agi auprès de "plusieurs acteurs". En conséquence, "vous avez aujourd'hui à la pompe une ristourne, parce qu'on a fait contribuer par exemple un acteur comme Total pour baisser les prix".
Pour savoir si l'Europe s'est inspirée du volontarisme français, comme le suggère Emmanuel Macron, il faut comparer les mesures prises en exemple et celles défendues par les instances de l'UE. En étudiant le timing des différentes annonces. Quand le président évoque la contribution demandée à EDF via l'Arenh (nouvelle fenêtre), il fait référence à une évolution de l'Accès régulé à l'électricité nucléaire historique décidée en début d'année 2022 (nouvelle fenêtre). Pour faire simple, EDF est tenu par une loi de 2011 de proposer aux fournisseurs d'énergie alternatifs un certain volume d'énergie à prix fixe. Lorsque les prix du marché de gros sont inférieurs à ce montant, les fournisseurs ont peu d'intérêt à se tourner vers l'Arenh puisqu'ils peuvent s'approvisionner ailleurs de façon plus économique. Quand les tarifs bondissent, comme on l'observe depuis de longs mois désormais, il devient par contre bien plus intéressant de profiter des prix fixes de l'Arenh, en dessous (voire très en dessous) du marché de gros. Logiquement, les fournisseurs alternatifs se tournent alors vers EDF.
Lire aussi
Budget 2023 : le gouvernement taxe énergéticiens et raffineurs, mais ne parle pas de "superprofits"
Le volume d'énergie fourni par EDF au titre de l'Arenh reste toutefois limité : il était jusqu'à présent de 100 TWh à l'échelle d'une année, soit environ 20% de la production globale d'électricité française. Pour compenser la période de crise actuelle, le gouvernement a annoncé la mise à disposition de 20 TWh supplémentaires d'Arenh pour l'année 2022, à partir du 1er avril (nouvelle fenêtre). De quoi réduire le coût d'approvisionnement pour les fournisseurs et éviter que la facture des Français ne bondisse trop fortement.
S'il s'agit ici d'une mesure visant à protéger les Français des hausses tarifaires, il n'est pas question ici d'une taxation des superprofits ou d'une forme de "contribution" de la part des entreprises du secteur de l'énergie. Quant à la négociation avec certains acteurs comme TotalEnergies, aussi évoquée par Emmanuel Macron, elle s'est bel et bien traduite par une baisse des prix à la pompe. Vingt centimes par litre dès le 1er septembre : un geste qui a soulagé les conducteurs, mais qui fut aussi avancé par le gouvernement pour justifier de ne pas taxer directement les superprofits.
L'Europe s'est montrée plus volontariste
Enfin, un amendement au projet de loi de finance, déposé le 7 octobre par le gouvernement, introduit (nouvelle fenêtre) une "contribution temporaire de solidarité" pour 2023 dans les secteurs de l’extraction, de l’exploitation minière ou du raffinage du pétrole. Seront concernées les entreprises dont le résultat dépasserait de 20% la moyenne des quatre dernières années. Il ne s'agit pas d'une taxe à proprement parler, et cette contribution fait suite à un accord conclu à l'échelle européenne fin septembre. Les ministres des Finances s'étaient alors accordés (nouvelle fenêtre) sur un plafonnement des revenus des producteurs d'électricité à partir du nucléaire et des renouvelables (éolien, solaire, hydroélectrique), ainsi qu'à un plafonnement à 180 euros du mégawattheure.
Il est important de souligner qu'à l'échelle européenne, la question des superprofits a été mise sur la table dès le mois de mars 2022. À l'époque, la Commission européenne prenait position : "Dans la situation de crise actuelle, les États membres peuvent décider, à titre exceptionnel, de prendre des mesures fiscales visant à récupérer une partie des bénéfices réalisés par certains producteurs d’électricité", écrivait-elle (nouvelle fenêtre). Le mot "taxe" est plusieurs fois évoqué.
Durant l'été, le Parlement européen notait (nouvelle fenêtre) sur son site que les eurodéputés allaient échanger "des mérites et de la manière la plus efficace d’imposer une taxe exceptionnelle sur les bénéfices des entreprises énergétiques". En passant, il était rappelé que "dans une résolution adoptée en mai (nouvelle fenêtre), les députés ont plaidé pour la création d’une telle taxe". Des prises de position qui tranchent avec celles affichées dans l'Hexagone : on se souvient par exemple cette phrase de Bruno le Maire, prononcée le 30 août devant les représentants du Medef. "Je ne sais pas ce que c’est qu’un superprofit", avait alors assuré (nouvelle fenêtre) le ministre de l'Économie.
Les débats observés à l'échelle européenne montrent bien qu'au sein de l'UE, la France n'a pas particulièrement fait office de précurseure. A fortiori au regard des textes qui ont fleuri chez nos voisins ces derniers mois, avant que n'émerge une réponse commune des 27 face à la crise. TF1info mentionnait ainsi (nouvelle fenêtre) les mesures prises en Italie dès mars 2022. Le gouvernement a notamment instauré, via un décret contre "l'énergie chère", une taxe de 10% sur les profits des entreprises de l'énergie. Cette taxe a été portée à 25% en mai. En Grèce, un amendement déposé en mai par le ministère de l'Énergie a prévu une taxation à 90% des profits exceptionnels des sociétés de production d'électricité. Roumanie, Espagne et Royaume-Uni se sont, eux aussi, mobilisés sur la question, instaurant des taxes et faisant évoluer leur législation.
Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur Twitter : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.
|


![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)



![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
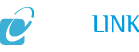

![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)